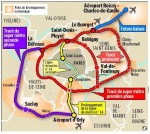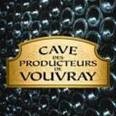Une renonciation à préempter est définitive
Conseil d’Etat, 12 novembre 2009 Société Comilux c/ Commune de Créteil, req. n° 327451, à paraître aux tables
 Extraits : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. / (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; que, selon l'article R. 213-8 du même code, Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption / b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; / c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...) ;
Extraits : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. / (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; que, selon l'article R. 213-8 du même code, Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption / b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; / c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...) ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées, qui visent notamment à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption puissent savoir de façon certaine et dans les plus brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise, que lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que le maire de Créteil a, par décision du 26 décembre 2008, expressément renoncé à exercer son droit de préemption sur un immeuble, situé dans cette commune, que la SOCIETE COMILUX avait déclaré vouloir aliéner au profit de la SOCIETE CHAVEST ; qu'il a retiré cette décision le 26 janvier 2009 au motif qu'elle aurait procédé d'une confusion entre des déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens immobiliers distincts reçues durant la même période ; qu'il a ensuite décidé le 9 février 2009 de préempter l'immeuble en cause ; »
 Commentaire : Décidemment, le régime du droit de préemption est atypique. Cette affaire dans laquelle la commune de Créteil indiquait s’être trompée en renonçant à préempter un bien, avant de tenter de se raviser, l’illustre une fois de plus.
Commentaire : Décidemment, le régime du droit de préemption est atypique. Cette affaire dans laquelle la commune de Créteil indiquait s’être trompée en renonçant à préempter un bien, avant de tenter de se raviser, l’illustre une fois de plus.
D’une façon générale, lorsque l’administration se trompe, elle dispose d’une espèce de droit au repentir. C’est le régime du retrait des actes administratifs. Afin de combiner légalité administrative et sécurité juridique, elle peut retirer, c’est-à-dire faire disparaître rétroactivement sa décision. Le retrait est très encadré : pour un acte créateur de droit, et sauf exception, le retrait doit intervenir dans un délai de quatre mois et la décision retirée doit être illégale.
Le particularisme d’une décision de préemption est qu’elle ne peut intervenir que dans un délai limité. D’après l’article L. 213-2 du code de l'urbanisme « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la (DIA) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption », ce qui veut dire que la décision de préemption doit parvenir au vendeur dans un délai de deux mois. Passé ce délai, le titulaire du droit de préemption ne peut plus légalement préempter un bien.
Comment combiner ce délai de deux mois pour préempter et la possibilité de retrait d’une décision renonçant à préempter, c’est-à-dire, pour être clair, est-il possible pour le titulaire d’un droit de préemption de préempter après qu’il y eut expressément renoncé ?
De façon intéressante, deux cours administratives d’appel (CAA Paris, 17 février 2000 Commune de Genevilliers, req. n° 97PA02115 ; CAA Lyon 27 mai 2008 Ville de Saint-Etienne, req n° 07LY00493) avaient analysé une décision de préempter comme un acte créateur de droit et lui avaient appliqué le régime du retrait des actes administratifs.
Mais, il semble que la question, non pas du retrait d’une décision de préemption, mais du retrait d’une décision renonçant à préempter, était inédite.
Appliquer le droit commun du retrait à une renonciation à préempter aurait présenté un inconvénient majeur, celui d’allonger la période d’incertitude dans laquelle se trouvent l’acheteur et le vendeur en leur laissant craindre que la non préemption puisse être retirée dans un délai de quatre mois. Si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout, cela aboutirait à leur imposer d’attendre six mois après la déclaration d’intention d’aliéner (2 mois de DIA + 4 mois de retrait) avant de conclure une vente. Un tel délai serait manifestement excessif.
Appliquer le droit commun du retrait aurait également été irréaliste. En effet, contrairement à une décision de préemption, le régime juridique d’une renonciation à préempter n’est pas encadré. Il peut donc être pronostiqué qu’une renonciation à préempter serait été très rarement illégale. La condition d’illégalité de la décision retirée serait donc rarement remplie.
Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt Comilux c/ Commune de Créteil adopte une position radicale : il écarte le régime du retrait et juge qu’il n’y a pas de retrait possible en cas de renonciation à préempter.
Qu’il n’y ait pas de retrait possible lorsque l’administration laisse passer le délai de préemption sans se prononcer est normal. D’abord, on peut hésiter avant de qualifier le simple silence gardé par l’administration sur l’information adressée par le vendeur de « décision implicite ». Ensuite et surtout, admettre un tel retrait aboutirait à permettre à l’administration de préempter au-delà du délai de deux mois, ce qui est contraire au texte même de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme.
Qu’il n’y ait pas davantage de retrait possible lorsque l’administration a pris une décision explicite avant l'expiration de ce délai, c’était moins évident. Cela signifie que l’administration se dessaisit de sa compétence et, alors même que le délai de deux mois n’est pas expiré, qu’elle ne peut plus revenir sur sa renonciation à préempter. De même, elle ne peut plus, après retrait, prendre une décision de préemption. Une telle décision serait donc également illégale.
Ce régime dérogatoire au droit commun du retrait des actes administratifs peut être expliqué par le caractère exorbitant du droit de préemption : il retarde, et quand il est exercé, il empêche, une vente immobilière. Cette gène doit être la plus légère possible. Aussi, pour le Conseil d’Etat, les textes applicables « visent notamment à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption puissent savoir de façon certaine et dans les plus brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ».
C’est cette même garantie de la nécessaire certitude que doit avoir un propriétaire de pouvoir vendre son bien « dans les plus brefs délais » qui a été récemment invoquée par le Conseil d’Etat pour encadrer la prorogation du délai d’instruction de la déclaration d’intention d’aliéner (CE 24 juillet 2009 Société Finadev, req. n° 316158).
Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat applique un régime juridique dérogatoire à un mécanisme qui ne l’est pas moins.
Benoît JORION
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public